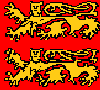 |
|
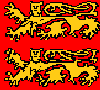 |
|
Assemblée générale du 13 décembre 2000
Histoire économique, Histoire
des entreprises :
Nouvelles Problématiques
conférence de
Jean-Pierre DAVIET
Professeur d’histoire contemporaine
Université de Caen Basse Normandie
Le propos est celui d'un professeur à l'université
de Caen Basse-Normandie plus que d'un théoricien de l'histoire économique.
Qu'est-ce à dire ? Je tiens compte de la réception
d'un certain message par les étudiants pour observer que l'histoire
économique "pure et dure" tient une place modeste dans un cursus
conçu pour être assez généraliste, ce qui fait
qu'il n'y a guère place pour l'enseignement de certains concepts
importants, et que d'ailleurs les étudiants ne raisonnent pas spontanément
à partir d'un point de vue économique. Ils s'attachent plus
volontiers à des identités locales (la Résistance
dans tel canton) ou sociale (les Juifs, la femme), voire politique (la
citoyenneté). Je ne le condamne absolument pas, et j'y vois des
raisons plus larges : un certain déclin du marxisme rend suspectes
les explications du déterminisme économique, et la dématérialisation
de notre univers quotidien éloigne des techniques, agricoles ou
industrielles.
Cela étant bien posé, je crois que les étudiants sont assez sensibles à l'effort que l'on peut faire pour présenter une histoire économique "humaine", reliée à des contextes culturels et politiques. Ils apprécient que l'on présente l'action sociale comme un système complexe d'interactions, où l'économie tient sa place, mais n'occupe pas tout le champ de l'intelligibilité. Enseigner l'histoire économique dans ces conditions constitue un défi, mais un défi stimulant, qui me semble rejoindre en fait des tendances profondes de la recherche depuis une trentaine d'années.
Je vais donc essayer de passer en revue des éléments
scientifiques ou épistémologiques de nature à conforter
l'approche de l'enseignant de DEUG et de licence, plutôt que de partir
du point de vue du pur chercheur, tel qu'on le percevrait dans une chaire
très spécialisée où l'on s'adresse à
de futurs chercheurs (en ce cas, on passerait en revue beaucoup plus de
sujets techniques que je ne le fais aujourd'hui). Et je pense qu'un tel
propos intéresse aussi l'enseignant du secondaire, car il n'y a
pas rupture entre l'étudiant qui arrive à l'université
et les élèves du lycée.
1. Quelques tendances de l'histoire économique en général :
On pourrait se contenter de dresser
un état des lieux, mais un détour épistémologique
est tout de même pertinent en préalable.
L'histoire économique est-elle plutôt de
l'histoire ou plutôt de l'économie ? La réponse ne
fait aucun doute pour moi, elle est tout à fait de l'histoire. Chaque
discipline scientifique repose sur un axiome premier qui lui donne sa légitimité.
Ainsi la géographie repose-t-elle sur la notion d'espace, plus précisément
sous l'aspect d'une inscription différenciée dans l'espace
de faits sociaux (est "géographique" tout objet qui différencie
la surface terrestre), les sciences de gestion sur la notion de ressources
à mobiliser sous certaines contraintes. L'économie fait une
hypothèse de rationalité, définie comme adéquation
entre une fin et des moyens, avec une norme d'optimum dans l'échange
(en ce sens, c'est une science du "comme si", on fait comme si les agents
se comportaient de façon rationnelle, on découpe dans un
réel foisonnant une sphère de la rationalité). L'histoire
a un rapport avec les traces du temps, le datable et la durée, en
insistant sur la pluralité des temps et des durées, entre
civilisations différentes, mais aussi à l'intérieur
d'une même société, cette notion de pluralité
faisant pendant à la notion de différence pour les géographes
(ce qui fait que l'historien est un peu géographe comme le géographe
est un peu historien). En ce sens, l'historien ne néglige aucun
aspect de l'action, des pratiques sociales et culturelles. Il s'attache
à l'inscription dans une durée de tous les faits sociaux,
où se mêlent de la permanence et du changement, de dynamiques
sociales à petite et grande échelle (interaction entre des
individus, des groupes, des pouvoirs). La question de l'optimum ne se pose
pas pour un historien, il se contente d'observer que certaines configurations
ont duré davantage que d'autres (d'où l'intérêt
de l'histoire chinoise par exemple), sans porter de jugement. C’est très
exactement dans ce cadre axiomatique et paradigmatique que je situe l’histoire
économique, dont je vais examiner quelques approches récentes.
En procédant à certains regroupements, je retiens trois thématiques.
1.1 La première thématique est relative à l’interaction entre sciences, techniques et innovation dans la dynamique sociale. Je résume énormément en disant que les historiens ont réinvesti l’histoire des sciences à leur façon, qui n’est ni celle des scientifiques eux-mêmes, ni celle des philosophes épistémologues. Les historiens insistent beaucoup sur les moyens du progrès scientifique, les appareillages bien sûr, les ressources humaines et financières à mobiliser. Un bon exemple est celui de la physique depuis 1939. La physique américaine a changé de nature en raison de financements de la recherche sur des budgets militaires par contrats avec les laboratoires universitaires. En même temps, les historiens mettent en perspective la vie de ces laboratoires en s’intéressant aux processus de décision dans le choix des projets, aux intérêts de carrière des universitaires, à leur capacité à susciter des enthousiasmes, à mobiliser des disciples.
Dominique Pestre en a donné un exemple en étudiant la vie du laboratoire de physique de l’Ecole normale supérieure rue d’Ulm, sous la direction d’Yves Rocard après 1945. Ce dernier, qui avait passé une partie de sa carrière dans l’industrie (entreprise de radio), puis fait de la Résistance en liaison avec les Anglais (problèmes de radar, de détection des ondes de sous-marins) a trouvé rue d’Ulm un laboratoire en ruine, sans ressources, avec des appareillages vieillots. Il a rebâti une école française de physique en signant des contrats avec la Marine nationale et le Commissariat à l’énergie atomique. On trouve là une configuration où interviennent la politique, l’économie, la sociologie.
Mais il est clair qu’en retour la science agit sur les techniques et l’économie, y compris et peut-être surtout par des voies qu’on ne prévoyait pas au départ. Donc émergence d’une prometteuse école française d’histoire des sciences, à laquelle j’ai apporté une modeste contribution caennaise par un sujet de maîtrise sur l’histoire du Ganil. Preuve s’il en est que l’on peut intéresser des étudiants à ces thèmes.
L’histoire des techniques a de vieilles lettres de noblesse, mais a été considérablement renouvelée sous l’impulsion de François Caron et de ses nombreux disciples. C’est une histoire moins internaliste que naguère, où l’on met en avant les réseaux de transfert ou d’imitation, les situations d’innovation, les cultures techniques (de l’ouvrier, de l’ingénieur), le progrès incrémental (pas à pas, par petites améliorations) plus que par grandes ruptures, le rôle de la demande sociale (notamment dans la société de consommation, avec les nouveaux objets, les nouveaux désirs).
1.2 Une deuxième thématique est celle du modèle de croissance. On s’intéresse peut-être moins au cycle court, excepté quand il comporte des aspects sociaux et politiques (1789, 1848, 1929). On cherche davantage à analyser par quels rythmes, par quelles voies originales chaque pays, et surtout la France dans la préoccupation des historiens français, est passé des économies traditionnelles à la société d’aujourd’hui. A vue d’aigle, il y a convergence de toutes les économies (par exemple on observe partout une diminution relative de l’emploi agricole), mais les étapes n’ont pas été partout les mêmes, on a traversé des configurations spécifiques (par exemple le Second Empire), où interviennent la politique au sens large (sous des aspects géostratégiques et internes), le jeu de certaines élites et des conflits de pouvoirs, la culture, des héritages.
1.3 Une troisième thématique est celle que j’appelle assez librement le retour à l’acteur, l’échelle du regard sur les acteurs. On a déconstruit en quelque sorte les grands agrégats que sont le capitalisme, la bourgeoisie, la classe ouvrière, l’Etat, pour redécouvrir qu’il faut s’intéresser à des hommes, afin de mieux reconstruire ensuite des ensembles aux contours plus perméables et changeants.
A la base, donc, des individus, des hommes concrets et réels. Cela se marque notamment par l’essor de la prosopographie : on décrit des caractéristiques précises d’un groupe significatif d’individus, à partir de quoi on cherche à élaborer des typologies. Mais c’est aussi la recherche sur les itinéraires de vie, les parcours, trajectoires et destins familiaux. C’est aussi les réseaux d’interconnaissance et de partage de l’information, la dynamique spatiale du petit territoire, les entreprises, un Etat qu’on étudie dans ses contradictions, c’est à dire le jeu de grands corps de fonctionnaires qui ont chacun leurs intérêts, les compromis entre groupes de pression, les hésitations des politiques, qui, en pratique, influencent l’économie, mais à travers le prisme d’objectifs autres qu’économiques (un bon exemple, le gaullisme). Ainsi donc diversité, pluralité, complexité.
Je vais maintenant en venir à un champ plus
particulier de l’histoire économique, l’histoire des entreprises.
En effet, je suis par mes recherches personnelles spécialisé
dans ce champ, qui s’est énormément développé
en France depuis les années 1970, même s’il y avait des prédécesseurs,
notamment Jean Bouvier, auquel je tiens à
rendre hommage. L’année 1992 a marqué la création
de la revue Entreprises et histoire, qui témoigne, sous l'inspiration
de Patrick Fridenson, de l'existence d'une sorte d'école française.
Je ne veux pas raconter ici comment s’est opérée cette émergence,
ni dresser un panorama de l’histoire des entreprises telle qu’elle s’écrit
en France, mais discerner quelques aspects de la réflexion théorique
actuelle.
2. Histoire de l’entreprise et nouvelles théories microéconomiques
Le propos que je m’apprête à tenir est en apparence contradictoire avec les développements ci-dessus. Je disais en première partie que chaque discipline scientifique avait son axiomatique, et que celle de l’histoire n’était pas celle de l’économie. Néanmoins je rappelle que Lucien Fèbvre avait invité les historiens à être géographes bien sûr, mais aussi sociologues, ethnologues, linguistes, juristes, et économistes. Cela signifie qu’un historien trouve son miel dans d’autres disciplines pour transposer des concepts, et développer une problématique. Si l’histoire des entreprises veut être autre chose qu’un récit, elle doit à mon sens poser ses problèmes en tenant compte du renouveau récent de la microéconomie. Pour un repérage théorique rapide, je m’inspire très librement de la bibliographie commode recensée dans Benjamin Coriat, Les Nouvelles théories de l'entreprise (1995), et je cherche des points d'application en trois domaines.
2.1 La question de l'entrepreneur
L'apport le plus riche vient du courant évolutionniste (Nelson, Winter, Teece, Dosi, auxquels on pourrait rattacher David et Freeman, et en France Dominique Foray), qui décrit des acteurs non totalement rationnels, des situations hétérogènes, un temps créatif où s'opère un cheminement et une sélection. L'innovation résulte d'interactions positives entre des agents dont les comportements se construisent au cours d'apprentissages.
L'entrepreneur n'est pas un homme seul. La notion de routine, à interpréter comme un savoir-faire, un savoir-répondre, fait comprendre que, dans les gênes ou les chromosomes d'une entreprise, il existe un répertoire de réponses pour faire face au changement. Les économistes évolutionnistes insistent sur la notion de portefeuille cohérent d'activités. Ils théorisent aussi l'idée d'une pluralité d'environnements de marché où s'opère la sélection. D'où une typologie qui tient compte de l'ampleur du périmètre de compétences, de la plus ou moins grande rapidité de l'apprentissage, de la sélection.
La question de l'entrepreneur apparaît encore dans d'autres approches, notamment dans celle des coûts de transaction, où l'on parle d'innovation organisationnelle, et aussi dans l'approche des droits de propriété, à travers la théorie de l'agence, qui est devenue un noyau dur de la microéconomie récente. Cette théorie explique comment un détenteur d'actifs, un propriétaire des moyens de production, un bailleur de fonds, délègue une fonction entrepreneuriale à un agent spécialisé, mais avec une spécification qui définit les obligations de ce dernier, pour qu'il n'aille pas contre les intérêts du bailleur de fonds, et, bien entendu, toute une zone d'ambiguïtés.
2.2 La question des hommes de l'organisation renvoie à de très nombreux points traités par les historiens, notamment la question de savoir si une organisation peut avoir un objectif, du genre maximiser le profit, et celle des performances organisationnelles.
Il semble très riche de considérer la firme, avec Williamson et l'approche des coûts de transaction, comme un noeud ou réseau complexe de contrats, ce qui a le mérite de renouveler le problème de ses frontières. Il y a une périphérie de la firme qui repose aussi sur des contrats. La proto-industrie est à interpréter comme montage complexe de contrats entre individus (tarif entre le marchand-fabricant et le travailleur à domicile, contrats dans la famille du marchand, avec ses fournisseurs et partenaires du négoce). Il y aurait aussi le cas de "districts industriels" où on trouve un tissu dense de PME interdépendantes, par exemple dans la région de Besançon, de Roanne ou de Cholet, voire dans les modernes technopoles, ou encore dans les diverses formes de sous-traitance. Toute une partie de la microéconomie conduit à une analyse fine des contrats, dits incomplets, entre un acheteur et un vendeur, un fournisseur de bien intermédiaire et un producteur, un sous-traitant et une grande firme (certains de ces contrats relèvent de la relation principal/ agent). Il est possible que certaines transactions exigent des actifs très spécifiques, actifs matériels ou humains, ce qui crée un lien d'interdépendance durable, parfois avec nécessité d'un arbitrage (on retrouve ici les coûts de transaction, et les problèmes d'internalisation).
A l'intérieur de la firme, on se trouve en présence d'une structure de gouvernance qui repose sur un ensemble de contrats, plus ou moins précis, autour de la relation d'emploi. Il semble aussi que cette théorie du contrat permettrait de renouveler un peu l'interprétation du paternalisme, comme phénomène quasi-contractuel, transaction où la confiance supplée l'insuffisance du marché. On a peut être trop fait du paternalisme une domination, un totalitarisme, alors qu'on pourrait l'analyser comme cas particulier de contrat incomplet.
2.3 La question de la firme comme institution postule que l'on ne peut gérer un pool de ressources sans faire intervenir des règles, des normes, avec des enjeux de partage des gains collectifs, des conflits d'intérêts, peut-être un marchandage pour définir des droits et obligations.
La démarche qui accorde le plus d'importance à l'institution est la théorie économique des droits de propriété chez une partie des néo-institutionnalistes. Par droits de propriété, il faut entendre un droit à choisir des usages d'un bien. Toute relation est échange de droits d'usage (c'est un peu ce qu'on entend par "transaction"). Cela fait référence à des coutumes, règles et normes de ce qui paraît légitime. Mais l'important est que ces droits de propriété ne peuvent pas être délimités clairement. Plusieurs agents peuvent prétendre avoir une portion de droit de propriété sur un actif, sans qu'il soit possible de mesurer la contribution individuelle de chacun (incomplétude des contrats).
On peut se référer à un exemple familier du XIXe siècle : un ouvrier est-il propriétaire de sa qualification, de sa compétence acquise ? Il croit l'être bien sûr, mais, en un certain sens, son patron peut estimer détenir lui aussi un droit de propriété, puisqu'il l'a formé, l'a mis en contact d'un matériel. Et il y aurait encore l'équipe de travail dont le contremaître pourrait se faire le porte-parole, estimant que cette propriété est collective. Plus le marché sera en déséquilibre, plus ces conflits seront résolus par une fonction disciplinaire (dépendance bilatérale).
Cette analyse permet de réinterpréter l'histoire des conflits ouverts et latents dans l'entreprise, en prenant au sérieux le discours de ces conflits, la nature des arguments échangés, étant aussi entendu qu'il n'y a pas uniquement des conflits collectifs, mais des conflits individuels, par exemple si un ingénieur revendique la paternité d'une innovation. L'étude des arbitrages, type prud'hommes, entre tout à fait dans cette perspective, comme espace de discussion avec des arguments, recherche d'une solution qui ne soit pas arbitraire.
Il semble que la théorie des droits de propriété au sens large pourrait servir à réévaluer l'histoire des rapports entre pouvoir financier, notamment des banques, et pouvoir industriel, avec asymétrie d'information : choix d'un bon partenaire ou d'un bon produit, moyens de réunir de l'information sur l'effort fourni, traitement de la question du risque. Il y aurait aussi les relations entre plusieurs instances de décision (économie électrique par exemple).
Pour finir, on ne peut complètement exclure une
allusion à la nouvelle théorie du consommateur. Cette
théorie prend en compte l'évolution des modes de consommation,
ce qui est important pour l'historien qui raconte comment de nouveaux objets
font leur apparition sur le marché (d'où un lien possible
avec une histoire anthropologique des produits comme celle de Daniel Roche).
3. Le patrimoine industriel comme approche
Depuis mon arrivée à l’université de Caen en 1998, j’ai développé une approche qui est plus nettement de patrimoine industriel, même si je ne romps pas avec l’histoire des entreprises. J’y vois plusieurs raisons.
D’abord le patrimoine industriel bas-normand est important et mérite une investigation universitaire (ayant attiré naguère l’attention de mes prédécesseurs Jean Vidalenc et surtout Gabriel Désert, auquel je rends un affectueux hommage). Ensuite il est l’occasion d’une convergence d’efforts qui réunit, à côté de l’université, des responsables de musées, d’associations, des élus, de simples curieux, souvent d’anciens ingénieurs ou ouvriers, parce qu’il est l’objet d’enjeux sociaux. Enfin, c’est un domaine concret où on apprend à lire un paysage, et en cela il intéresse plus les étudiants que des abstractions. Prenons un exemple très simple : on se rend sur le carreau d’une ancienne mine de fer où on ne voit plus grand chose. On peut expliquer qu’on peut, grâce à la couleur de l’herbe un peu différente, repérer le tracé en courbe d’une ancienne voie de chemin de fer de desserte, qu’un cercle un peu affaissé marque la trace d’un ancien puits. La forme des fenêtres d’une usine agroalimentaire a une signification. Le patrimoine plaît parce qu’il favorise une pédagogie de la découverte. J’ajouterai que nous avons à l’université de Caen un enseignement de l’archéologie susceptible de s’appliquer au patrimoine industriel.
Je ne cherche pas à développer ici une véritable analyse de ce que l’on peut appeler patrimoine industriel. Je retiens simplement trois idées essentielles. D’abord il est défini par la diversité de traces plus ou moins visibles et présentes sous notre regard. Ensuite il est patrimoine matériel. Enfin il est aussi patrimoine immatériel au sens de cultures techniques, références de l’imaginaire collectif, et on rejoint la notion de " lieux de mémoire " chère à Pierre Nora.
3.1 Diversité du patrimoine industriel
La diversité se marque d'abord dans l'interférence des temporalités. Le patrimoine n'est pas d'une époque, il est de toutes les époques, et il convient par conséquent de se doter d'instruments d’analyse à l’échelle des temps. Un processus d’industrialisation, certes complexe et inégal, mais puissant, a emporté les sociétés occidentales dans ce qu’on appelle généralement une économie industrielle, dont l’apogée s’est situé vers 1970. Le mouvement comportait une part d’utopie, une promesse de bonheur, par la mise en œuvre rationalisée à grande échelle d’une intelligence ordonnatrice, dans une démarche collective d’hommes engagés dans des processus de production répétables, se perfectionnant sans cesse par un échange transparent de l’innovation, qui est une destruction créatrice.
Comprendre en profondeur l’avènement de l’économie industrielle nécessite une plongée dans la très longue durée, et il ne fait pas de doute que les strates se sont superposées, avec des ruptures, des reculs, des recouvrements, mais aussi une dynamique du progrès technique. On parle déjà d’une industrie de la préhistoire. Les historiens ont pris l’habitude d’appeler proto-industrialisation une première phase de développement de l’industrie. Mais cette proto-industrialisation est surtout pertinente pour analyser l’industrie textile en partie dispersée : dès la fin du Moyen Age, l’industrie métallurgique annonçait les fabriques plus récentes. La proto-industrialisation s’est parfois prolongée jusque vers 1880, mais d’autres fois s’est transformée en première industrialisation à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle, avec ce qu’il est convenu d’appeler première révolution industrielle.
En fait, la réalité est toujours diverse et mélangée, et l’évidence palpable du terrain le rappelle en permanence : on n’y retrouve pas les types purs des grandes classifications abstraites. Une révolution industrielle met cent ans à épuiser ses effets. La deuxième révolution industrielle commence vers 1880, avec l’électricité, le moteur à explosion, la grande usine, les tendances à la production de masse. Et elle ne s’achève que vers 1970-1980. Nous sommes entrés depuis lors dans ce que certains historiens appellent une troisième révolution industrielle, celle de l’informatique, des automatismes, de la communication généralisée et des constructions virtuelles.
La diversité est ensuite présente dans les sites industriels, mines et carrières, moulins, ateliers, manufactures, fabriques et usines. Qu'est-ce qu'un site industriel ? Un lieu où s’est exercée une production industrielle, et où une mémoire permet de découvrir toujours certaines marques sur le terrain proprement dit, et même au-delà, dans un paysage. Le site se loge dans un paysage en même temps que l’industrie crée le paysage, rural, urbain ou suburbain. Mais le témoignage matériel d'aujourd'hui peut être discret, peu apparent : c'est au chercheur de déchiffrer ce qui peut l'être en combinant des représentations anciennes, des fouilles peut-être, en tout cas une observation fine et précise de la topographie et du bâti, le tout en liaison avec l'exploitation d'archives et autres sources (photos, cartes postales etc.). La démarche de découverte et d’étude du patrimoine industriel met en mémoire, ordonne la mémoire, compare et explique.
Enfin, diversité dans l'organisation du site, les architectures industrielles. L'organisation des sites de production a naturellement évolué au cours de l'histoire. Elle varie aussi selon les activités exercées. Un moulin à grains de type traditionnel n'a souvent donné lieu qu'à un aménagement modeste : parfois un bassin de retenue, de petite taille, plus souvent un simple canal de dérivation donnant l'eau à une ou plusieurs roues hydrauliques. L'espace de travail et le logement du meunier sont réunis dans un même bâtiment, à proximité duquel se trouve fréquemment une porcherie - les résidus de farine permettant d'engraisser quelques porcs - voire quelques autres bâtiments à vocation agricole trahissant l'aspect avant tout rural de la mouture des grains. On passe ensuite à la grande minoterie, telle les Grands Moulins de Paris ou de Corbeil.
Le XVIIIe siècle a souvent été caractérisé, dans les grandes manufactures, par une réflexion sur l’aménagement de l’espace où la pensée de l’utile s’entremêlait d’une préoccupation esthétique et d’une utopie du regard (Nicolas Ledoux à Arc et Senans). Etroitement dépendantes de l'énergie hydraulique, la plupart des usines sont, jusqu'au milieu du XIXe siècle, construites à la campagne, bien qu'il existe aussi des ateliers dans les villes et les faubourgs, notamment pour la teinture des étoffes, la tannerie, l'imprimerie, la mécanique, le tabac, pour des raisons de main d’œuvre.
L'emploi d'une nouvelle source d'énergie, la vapeur, les affranchit de cette contrainte et facilite leur implantation en ville, les hautes cheminées en brique, parfois ornementées, devenant avec le clocher des édifices religieux ou les beffrois de la ville un nouveau signal. Mais rurale ou urbaine, l'usine ne manque pas de concentrer ses acteurs. Dès l'époque moderne, les logements du patron, du contremaître et des ouvriers, souvent pourvus de jardins potagers, côtoient l'atelier.
A partir du XVIIe ou du XVIIIe siècle parfois (Villeneuvette), et plus encore du XIXe siècle s'établissent des lotissements, pour ouvriers, contremaîtres, ingénieurs, le développement des mouvements ouvriers et les progrès de l'hygiène s'accompagnant aussi peu à peu de l'ouverture de locaux syndicaux, d'infirmeries, de vestiaires, de douches, de cantines, voire de services sociaux comme les crèches ou de bibliothèques. Très souvent, à partir de 1840 et plus encore à la fin du XIXe siècle, l'usine s'entoure d'une clôture, mais cela dépend des secteurs.
En présence d'un site industriel, il importe toujours de se référer à une grammaire des lieux, en entendant par là la dimension du temps - date de construction des éléments du bâti et évolution de leur affectation - le paysage - manière dont le site s'intègre dans un paysage, forestier ou rural, de vallée industrielle, de ville, de banlieue - l'aménagement ou la disposition du site, les caractères du bâti. C’est par l’échelle, la cohérence architecturale, l’emploi des matériaux que s’exprime une puissance symbolique, parfois dans un souci de réclame, parfois pour afficher une pensée patronale (Noisiel). C’est d’ailleurs souvent cette puissance symbolique qui contribue à la survie du site (maisons de champagne par exemple).
3.2 Un patrimoine matériel
Le patrimoine matériel comprend le bâti de l'usine, les outillages techniques, moteurs et machines, les produits destinés aux marchés.
Quelques mots d'abord sur les états du bâti entre conservation et destruction. Le patrimoine industriel tel qu'il s'offre aujourd'hui à nos yeux peut être vivant dans certains cas, y compris d’une vie détournée de sa fonction première, mais aussi désaffecté ou en attente d'un hypothétique devenir. Lorsqu'elle cesse toute production, l'usine, plus que tout autre élément du patrimoine, est menacée. La nature a tôt fait de reprendre ses droits et la rouille trouve ici une victime de choix. Très souvent se posent aussi de gros problèmes de sécurité, voire d'environnement. L'usine en ruine ne dégage pas toujours le charme et l'attrait de la ruine romantique que peuvent offrir les vestiges d'un château ou d'un édifice religieux. La nouvelle ruine d’aujourd’hui peut susciter l’émotion, inspirer l’imagination, mais elle est aussi perçue comme reproche et gêne.
Entre la mort et la vie, la mémoire de l'industrie peut être de différentes natures. Souvenir de toponymie ; noms de rue ou souvenir indirect de l'industrie, noms de villages ou hameaux : la glacerie, la verrerie, les forges, le martinet… Friche après démolition d'une usine… Usine en cours de démolition… Ruine plus ou moins à l'abandon… Ruine, mais protégée, visitable parfois, partiellement restaurée… Bâti conservant, au prix de quelques transformations, la même activité : la question est de savoir pourquoi justement on l'a conservé, ce n'est pas indifférent… Bâti reconverti dans une autre fabrication industrielle (on a toujours conservé et adapté, pour des raisons d’économie)… Bâti ayant été transformé pour un usage non industriel, et là tout est concevable…
D'une façon générale, l’usine arrêtée et tombant peu à peu en ruine est porteuse de valeur négative, d'où l'alternative : tout démolir, ou réhabiliter.Démolir, c’est faire disparaître tout lien physique avec les références mentales toujours présentes. L'usine désaffectée peut faire l'objet d'une reconversion industrielle, mais, pour les ateliers du XIXe siècle, de telles reconversions ne sont pas toujours faciles : dispersés à la campagne, souvent éloignés des grands axes de circulation, construits sur plusieurs niveaux, ils ne répondent plus aux besoins actuels d'aménagement des sites qui voient la verticalité céder à l'horizontalité, bien que des architectes élaborent des projets de reconversion avec des aménagements multimodaux. On peut alors offrir à l'usine des usages autres qu'industriels.
Les techniques se réfèrent à la manière de fabriquer un produit, avec des outils, des machines, dont les plus simples sont entraînées par l'homme - un rouet à filer, les premières machines à coudre -, d’autres par des chevaux (manèges), mais la plupart nécessitent un moteur utilisant une énergie autre que musculaire. Les fours et fourneaux mettent en usage une énergie thermique, complétée parfois par l’énergie mécanique d’un soufflet mis en mouvement par une roue hydraulique. Toutes ces techniques ne sont pas indépendantes du bâti, en ce sens que l'organisation du site et l'aménagement des bâtiments traduisent une solution technique.
Une partie des techniques anciennes est relative à du travail dispersé, urbain et rural, qui a laissé peu de traces, mais en a laissé tout de même de façon indirecte. On voit encore de nos jours des bâtiments d'habitation qui ont été jadis des espaces de travail (Place des Vosges à Paris, Alençon). Et le travail dispersé était souvent complémentaire de finition en ateliers plus vastes comme dans le cas de la manufacture de Sedan. Les fabriques anciennes comportent quelques grands types : type où la main intelligente est très importante - imprimerie, ébénisterie, métiers d'art - type hydraulique - plus large que ne le donne à penser la notion de moteur hydraulique, car l'eau sert aussi en teinturerie, mégisserie… - type à feu - métallurgie, verre, céramiques - et toutes sortes de formes mixtes.
Vers 1900 ou même 1920, une même usine juxtapose des techniques qui paraissent hétérogènes. Une usine de construction de voitures compte par exemple des machines-outils qui usinent des pièces métalliques avec une grande précision, pièces uniformes donc, encore qu'il ait fallu régler la machine convenablement, souvent avec des manivelles. Mais il y a aussi des ateliers de montage-assemblage, notamment pour des éléments d'ossature de la carrosserie en bois (jusqu’à ce que les années 1920 fassent triompher le corps de carrosserie tout acier " tout acier ", innovation révolutionnaire de 1922 chez le constructeur américain Hudson, qui modifie les compétences à l’intérieur de l’entreprise).
La notion de révolution technique est intéressante quand on raisonne à une échelle globale de branche et en survolant une grande période, elle demeure assez peu opératoire à chaque fois qu'on étudie une usine particulière où se mêle de l'innovant pour l'époque et ce qui était alors courant, habituel. On a pu voir un ouvrier limer une pièce à la main à côté d’un espace de travail à la chaîne… Penser la révolution technique, pour le chercheur du patrimoine, c’est chercher et dater des mutations sur un fait précis, par exemple la réunion des métiers à tisser, anciennement dispersés, dans une usine de tissage de Roubaix au XIXe siècle (processus qui s’est étalé dans le temps), et ce n’est pas forcément la même chronologie dans les autres centres producteurs. Cela s’est parfois accompagné de crises sociales, dues à des contractions et à des réaménagements de l’emploi.
L’image que renvoie le patrimoine matériel des sites, des plans et des machines est le plus souvent décalée par rapport à la fonction première : l’usine ne fournit plus aujourd’hui en série des biens considérés à leur époque comme utiles ou désirables pour tel ou tel type de marché, qu’il s’agisse de consommation courante ou de produits de luxe. Il serait frustrant de considérer un lieu de production sans avoir une idée de son utilité pour la société, et sans considérer les chemins que prenait le produit pour arriver jusqu'à un consommateur plus ou moins lointain.
On peut s'interroger d'abord sur le lieu où on peut voir ces produits, et plus largement sur les lieux de mémoire de ces produits. Dans certains cas, un ancien site productif est aussi musée industriel. Dans d'autres cas, un musée regroupe des collections spécifiques d'objets sans que ce musée soit lui-même installé dans une ancienne usine. Parfois, les objets sont visibles dans un paysage - tuyauteries, éléments de poteaux et de ponts, plaques et colonnes métalliques, parfois simple plaque d'égout, revêtements de murs et de toitures - ou même un monument, qui n’est pas forcément industriel par sa fonction (simplement, il utilise des produits industriels), mais qui peut l’être (cheminées, grandes usines) : verrières, décors et mobiliers. Le bâtiment ou l’immeuble sont restés sur le site, ils utilisent par exemple des tuiles, des ardoises, des briques de différentes couleurs, que l’on a fabriquées non loin de là. En ce sens, le bâti peut être considéré comme produit industriel (et même la ville est produit industriel). L’archéologie étudie des " marqueurs " de l’évolution technique en longue durée : à partir de silex, de pièces de bronze, de céramiques, dont on analyse les formes et la composition chimique, on fixe un cadre chronologique, on trouve des relations entre des régions de consommation et des centres producteurs.
Ou bien des collectionneurs achètent et conservent des objets qui circulent donc sur un marché, et on peut en voir chez des particuliers : porcelaine, faïence, grès, briques estampées du XIXe siècle, objets de verre, montres et horloges, bijoux, vieilles bicyclettes, motos et voitures, anciens appareils photos... L’intervention de l’antiquaire est un signe de la valeur marchande du produit, et aussi un signe du travail de la mémoire. Ou bien encore, il existe une iconographie soit de l'objet - ouvrages, cartes postales - soit de la publicité qui l'a entouré - affiches, marques et logos, boutiques et réseaux commerciaux - soit encore d'autres articles qui l'ont accompagné : allumettes, pipes et tabatières pour le tabac, contenants divers et emballages. Parmi les figues emblématiques : le Bibendum de Michelin, le double chevron de Citroën, le chocolat Menier, la cigogne des Potasses d’Alsace, l’étoile de la bière d’Armentières. Enfin, dernier cas, la mémoire reste vivante en ce sens que telle bière, tel fromage, tel article de vêtement restent fabriqués dans la même région, même si les techniques de production ont évolué. Même en cas de restructuration industrielle et financière, on veut conserver une marque, qui signifie quelque chose pour le consommateur.
3.3 Un patrimoine immatériel
Considérer le patrimoine immatériel revient à s'intéresser d'abord aux gestes, compétences, savoirs de la technique, ensuite aux mondes du travail, enfin aux identités nées de l'industrie.
Au départ, il y a peut-être le geste, geste d'une main guidée par l'intelligence, comme on le voit déjà chez l'homme préhistorique aux prises avec la matière. Mais ce geste qui constitue le travail matériel est aussi culture. Est culture toute activité humaine où l'on a appris certains comportements collectifs, où l'on se fixe des buts avec des exigences, où l'on évalue une réussite avec des références du bien, où l’on exprime ses pensées, ses sentiments dans des formes acceptées. Entre gens d'une culture, on se comprend, même quand on ne parle pas, grâce au langage des gestes et des postures.
On parle très justement d'un tour de main pour dire qu'il faut savoir si la couleur du métal en fusion est la bonne, effectuer l'opération dans de bonnes conditions de façon très exacte. En fait, si quelque chose ne va pas, on anticipe déjà par la pensée quel sera le défaut dans la pièce finale. L'opérateur, à son niveau, est un preneur de décision, à partir d'une information qu'il sait maîtriser. D’où l’importance de l’apprentissage dans l’usine, de la transmission des qualifications au travail. Les responsabilités se sont déplacées au fur et à mesure que des écoles techniques, des formations professionnelles extérieures à l’entreprise se sont développées.
Un enjeu capital, surtout à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, fut de constituer un discours sur la technique. Il y avait une parole de la technique, mais codée en quelque sorte, réservée à des initiés, avec ses mots, son vocabulaire descriptif, et puis ses silences, ses allusions, ses secrets et ses ignorances. Il s'agissait d'abord de décrire, de représenter, démarche de l'Encyclopédie de D'Alembert et Diderot. Et, petit à petit, par-delà la vulgarisation et la diffusion, on voulut chercher les raisons, les explications, constituer un discours de la science pratique, améliorer la technique grâce une connaissance intellectuelle. Il y donc une gradation du geste au savoir-faire, puis au savoir de la technique.
Le geste pourrait donner à penser que l'on considère un homme seul face à la matière et à la technique, même s'il a été question d'une culture partagée. Dans de nombreux cas, l'étude d'un site industriel donne la vision d'un espace collectif de travail, et des particularités architecturales suggèrent l'organisation de cet espace, subdivisé en ateliers où le produit en élaboration circule en faisant appel à différentes compétences mobilisées au même moment. Des hommes s'approprient cet espace, en tenant compte de contraintes techniques - ateliers plus ou moins vastes, présence de machines, d'un four peut-être, de récipients contenant différents liquides, avec ou sans fenêtres - mais aussi des rapports qu'ils entretiennent avec leurs outils, entre eux et éventuellement avec des supérieurs. En même temps, il existe un cloisonnement à l'intérieur d'une même usine : un ouvrier des laminoirs peut n'avoir jamais vu la coulée du haut fourneau. L’espace est en partie fermé, isolant autant de mondes mystérieux.
Percevoir la vie matérielle d'un ensemble d'hommes au travail dans un espace de bruits, de poussières, d'odeurs, de chaleur demande un effort d'imagination, qui s'appuie sur une iconographie : dessins plus ou moins anciens à but technique, peintures et ouvrages de vulgarisation du XIXe siècle, photographie, films. Il n'est pas toujours évident que l'on s'intéresse au vêtement d'un ouvrier, ou à des conditions d'hygiène, mais il existe une littérature de médecine et d'hygiène du travail, de même que des documents sur la composition de la main d’œuvre - présence de femmes, d'enfants notamment - et sur les risques d'accidents du travail. Le travail lui-même, dans ses aspects techniques, n'est pas séparable des conditions de travail : horaires, rémunérations, fatigue et usure des hommes.
Si l’on voit l'industrie comme un effort collectif, on est sensible à la fois à ce qui rassemble dans un même espace, et à ce qui différencie. Un atelier peut réunir des spécialités de métier et de la manutention, même si ce dernier type d’activité a peu à peu disparu au fur et à mesure que l'on mécanisait certaines opérations et que le produit circulait sans intervention humaine directe. De même faut-il faire intervenir des conditions de carrière, de trajectoire professionnelle, car une personne n'est pas nécessairement toute sa vie dans la même position - l'ouvrier devient parfois contremaître, parfois technicien - et la main d’œuvre peut être plus ou moins instable dans certaines de ses composantes.
Le travail est savoir-faire, mais aussi savoir-être, sociabilité avec ceux que l’on côtoie comme des égaux dans un acte qui produit, rapports avec des chefs. A partir du moment où on réunit des hommes, une grande question est celle de l'autonomie, de la coordination, de l'organisation, de la discipline d’atelier, dont un des aspects est l'existence de règlements d'usine au XIXe siècle. Ce problème existait moins avant le XIXe siècle, dans la mesure où chacun prenait en charge et maîtrisait une opération ou une pièce.
La question d’une identité née de l’industrie mêle deux niveaux, ou deux dimensions, qui ne sont pas sans liens, mais n'appartiennent pas au même registre. D'un côté, il existe un pôle qui s'organise autour de l'entreprise, définie comme communauté, même si elle est traversée de conflits petits ou grands, volonté commune pas toujours aussi unie qu'elle voudrait l'être. De l'autre, il s'agit de la force intégratrice et identitaire du travail dans des solidarités plus larges.
L'entreprise a-t-elle toujours existé ? Pas sous la forme que nous lui connaissons en tout cas, puisque le mot ne prend son sens de communauté organisée que vers 1900, même si une certaine réalité de l'entreprise était plus ancienne, dans les forges, les mines, les manufactures et fabriques notamment. Si l’on regarde des maisons de tisserands du XIXe siècle telles qu'elles subsistent dans une ville comme Alençon, on perçoit que des formes de travail à domicile réunissaient intimement un espace de travail à la vie personnelle et familiale, avec une autonomie au quotidien, même si ce travail était dépendant d'une autre façon, puisqu'on livrait le produit de son travail à un négociant-fabricant. Le passage à l'usine, lent et inégal, a signifié agglomération de main d’œuvre en un lieu. La socialisation du lieu est moins grande dans le monde des bureaux et du tertiaire.
Dès lors, le patron veut stabiliser et contrôler la main d’œuvre. Un des témoignages essentiels qui en subsistent est le logement ouvrier, dont on rencontre des exemples anciens. La constante de longue durée est le souci de disposer d'un noyau de main d’œuvre sûre. La plupart des protofabriques étaient des industries à feux : on voulait que les ouvriers résident près des feux, parce qu'il fallait pouvoir se rendre à tout moment à la forge ou à la verrerie, y compris en pleine nuit, parfois par appel au tambour. En outre, certains bons spécialistes étaient mobiles : ils travaillaient quelques années à un endroit, puis allaient à un autre. Arrivant sur un site, ils n'y trouvaient par conséquent pas un logement de famille, il fallait bien les installer quelque part. Mais une fabrique utilisait aussi une main d’œuvre aux contours flous et changeants de charretiers, bûcherons, charbonniers et hommes de peine qui n'étaient pas logés.
Le XIXe siècle a, dans certains cas, surajouté à cela une intention plus idéologique. Les compagnies de chemins de fer, ayant constaté que leurs ouvriers s'étaient " mal comportés " en 1848, décidèrent de délocaliser leurs ateliers de réparation-entretien dans des cités cheminotes isolées, comme Laroche-Migennes. L'école de Le Play mit en avant la notion de " patronage ", qui convenait à des usines de taille moyenne, où l'ouvrier connaissait ses chefs : un engagement mutuel, un contrat moral.
On a voulu parfois encourager la famille, l'éducation de l'enfant, d'où l'attention portée à la maison. Mais cela ne supprimait pas les raisons économiques : les compagnies minières bâtirent des corons parce qu'elles voulaient des mineurs professionnalisés, et non plus des paysans-mineurs, ne descendant qu'épisodiquement au fond. Il y eut aussi des usines-pensionnats, pour des jeunes filles pas encore mariées - de 15 à 25 ans - surtout pour le moulinage de la soie… On estimait qu'il fallait des doigts de fée pour tirer un fil de 300 mètres sans le casser. De tels sites sont clos, le portail d'entrée ressemble à celui d'un couvent ou à celui d'un internat.
Les logements ouvriers, complétés par un réseau de magasins, écoles, terrains de sport, ont donné lieu à la notion de paternalisme. Il ne faut néanmoins pas imaginer qu'à aucun moment le contrôle des esprits a été total, à supposer qu'on l'ait cherché. Il y a toujours eu une sociabilité particulière en milieu ouvrier, et puis des compromis partiels et instables avec l’autorité patronale, des accommodements provisoires engageant plus ou moins la personnalité. Dans la proximité de l’usine et des logements ouvriers se forge un microcosme particulier. Le syndicalisme ouvrier, qui a pris son essor à la fin du XIXe siècle, s’est bâti sur les solidarités ouvrières et a bâti un contre-pouvoir.
En un sens plus large, le travail est élément central d'une identité. Il réunit des hommes et des femmes qui sont peut-être d'origines diverses, de conditions différentes, mais on va aussi se sentir gens du fer, gens du verre, gens de la bière, gens de la laine. Il s’agit d’une culture technique, de sentiments et d’expériences que l’on partage, des choses que l'on transmet. Il en résulte deux sortes de phénomènes, des diversités et une unité.
On peut ainsi évoquer une forme de diversité à travers le travail de la femme, ou celui des enfants au XIXe siècle, l'apport des immigrés et la diversification des emplois : de la secrétaire à l'ingénieur, en passant par l'employé en col blanc. Parallèlement, des liens communautaires existent lorsque l’on fait référence à une formation technique, à l'apprentissage au sens large et au sens propre ou à l'apparition d'écoles de formation. De même, la valorisation du travail par la qualité du produit permet aux salariés de gagner en force de négociation, en même temps qu'un réel sentiment de l'honneur. Mais cette culture du travail s’est affaiblie dès lors que l’on passait moins de temps au travail, davantage dans la famille et les loisirs.
L'identité, c'est aussi le souvenir de luttes sociales, d'événements fondateurs comme la fusillade de Fourmies en 1891.
En conclusion, je crois que l'histoire économique reste un chantier très vaste, qui suppose un investissement intellectuel, parce qu'il faut se former à l'économie, à la gestion, un peu aussi à la sociologie, beaucoup aux techniques, mais qui n'éloigne pas réellement du grand corps de l'histoire générale. L'histoire économique est certainement difficile à enseigner, mais les nouvelles problématiques nous rapprochent sans doute des attentes des étudiants. En tout cas ma conviction est qu'elle contribue à la compréhension du présent, y compris à ce que nous appelons "nouvelle économie", peut-être pas aussi nouvelle que le croient les journalistes.
décembre 2000 - Tous droits réservés - JP Daviet - APHG Régionale de Caen