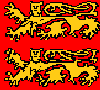 |
H&G - Chronique Internet Enseigner l'Histoire, la Géographie, l'ECJS |
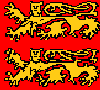 |
H&G - Chronique Internet Enseigner l'Histoire, la Géographie, l'ECJS |
Conférence Journées de l’APHG à
Poitiers, 27 octobre 2004
Le géographe, les cuisines
et le goût
. Par Gilles Fumey, Université
Paris-IV
(version pdf : http://aphgcaen.free.fr/conferences/gfgout.pdf Au seuil de cette réflexion, nous pensons aux historiens qui ont livré de très belles et fécondes recherches sur cette question de la cuisine et de l’alimentation, principalement autour de Jean-Louis Flandrin. Elles ont permis, avec les travaux des anthropologues (C. Fischler) et des sociologues (J.-P. Poulain) de montrer combien l’acte de manger que nous répétons trois fois par jour au moins, en Europe du monde, a très peu de sens pour la majorité des mangeurs qui ne connaissent pas le pourquoi de leur alimentation, alors que les sciences humaines (mais aussi biologiques avec H. This) peuvent éclairer d’un jour singulier ce qui se passe sur nos tables, ce qui se passe sur le plan économique avec les conflits d’intérêts dans l’agroalimentaire, ce qui se passe sur le plan sanitaire avec le scandale de la faim (qui inspire toujours de nombreuses actions humanitaires) et la question de l’obésité ou, plus simplement, du surpoids qui touche de plus en plus d’êtres humains dans toutes les parties du monde. On peut aller plus loin en se posant la question de savoir pourquoi les hommes cuisinent, et pourquoi ils cuisinent chez eux alors que tant d’activités de leur vie quotidienne a été délégué à des groupes qui s’en chargent (la santé, l’éducation, la sécurité, etc.). On pourrait, enfin, se demander pourquoi nous investissons tant dans nos cuisines au moment même où les femmes travaillent de plus en plus hors du domicile (plus de 90% aux Etats-Unis)… Les géographes peuvent-ils prendre le mouvement de la réflexion sur ces questions largement abordées par les historiens ? Ont-ils tout simplement quelque chose à dire ? Et ont-ils ouvert des pistes, justement dans le sillage des historiens, sur cette question de l’alimentation ? On pourra citer C. Thouvenot et ses recherches originales dans l’Est de la France (la diffusion de la tarte à l’oignon et du chou rouge), J.-R. Pitte et sa Gastronomie française parue il y a une bonne dizaine d’années. Les festivals de Blois et de Saint-Dié ont repris, tous les deux, ce thème des nourritures terrestres et à l’occasion du FIG ont proposé aux éditions Autrement l’édition d’un Atlas mondial des cuisines et gastronomies. Ce travail a permis de faire un certain nombre de constats :
1. Ce que manger et cuisiner veut dire Nous sommes ce que nous mangeons Pour bien comprendre cela, il faut d’abord rappeler que
nous ne consommons pas tout ce qui est biologiquement comestible. Car les
aliments sont porteurs de sens. En tant qu’omnivore, on peut potentiellement
tout manger, mais comme l’a fait remarquer C. Lévi-Strauss, il ne
suffit pas que les choses soient bonnes à manger. Il faut qu’elles
soient bonnes à penser. (…) Il existe des règles culinaires
complexes qui nécessitent d’opérer des associations entre
certains aliments ou, au contraire, des interdits. De la même manière
que certaines de nos phrases sont mal construites, il existe des impropriétés
alimentaires (Fischler).
Pourquoi devenons-nous ce que nous mangeons ? Parce que incorporer un aliment, c’est incorporer sur un plan réel comme imaginaire, tout ou partie de ses propriétés (Fischler). L’aliment transfère analogiquement au mangeur certains de ses caractères. La viande rouge et le sang sont supposés donner de la vigueur. C’est ce qui a été très bien étudié par l’OCHA, publié par Autrement dans Manger magique (novembre 1994). A ce titre, la nourriture est garante et constitutive
de notre identité. Cette représentation de l’incorporation
semble en fait traduire une caractéristique essentielle du rapport
de l’homme à son corps. L’incorporation est fondatrice de l’identité
collective et, du même coup, de l’altérité. L’alimentation
et la cuisine sont un élément tout à fait capital
du sentiment collectif d’appartenance. Dans certaines situations de migrations
ou de minorités culturelles, on a pu observer que des traits culinaires
persistent alors que la langue d’origine est oubliée. Les hommes
marquent leur appartenance à une culture par l’affirmation de leur
spécificité alimentaire.
Ce que cuisiner veut dire On a plusieurs paradigmes mais on peut en retenir deux : - la cuisine est la réalisation de formules pour atteindre un objectif autant sanitaire que nutritionnel. La répétition codifiée de recettes, de génération en génération, est une technique qui s’est généralisée au cours du développement des sociétés agricoles pour compenser le resserrement de la consommation autour d’un ensemble d’aliments plus réduit, une tentative pour optimiser l’utilisation de ressources dans un environnement nouveau et sanitaire dégradé. - les cuisines se déplacent, depuis les grandes
zones de richesse alimentaires où sont nées les sociétés
agricoles. Mais certaines zones sont florissantes ou endormies ou dominées
mais cela n’infirme pas le modèle originel. Les géographes
peuvent penser ces déplacements et apporter leur pierre à
la compréhension du savoir culinaire.
2. Comment penser une géographie des cuisines ? L’expérience des repas géographiques m’a amené à constater et penser des constantes dans la manière dont les hommes ont conçu leurs repas. Même si manger, même si les prises alimentaires ne se font pas toujours par le repas. Il faut partir du sens et des représentations qu’on a de l’alimentation dans le monde, même si ces représentations-là évoluent dans le temps. On ne peut pas traiter en quelques instants des manières de manger des gens de l’Antiquité, des Précolombiens, des Chinois et des Indiens pour prendre les grands foyers de peuplement. On ne peut pas être dégoûté par l’anthropophagie des Aztèques sans comprendre quel sens ils donnaient à ces repas. Disons, pour faire brièvement, que les cuisines en Occident se sont organisées à partir du discours de la médecine grecque qui a construit un idéal gustatif qui n’a pas fondamentalement changé depuis plus de deux mille ans. Son principe essentiel est que chaque être vivant – homme, animal, plante – possède une " nature " particulière due à la combinaison de quatre facteurs : chaud et froid, sec et humide, expression à leur tour des quatre éléments (feu, air, terre, eau) constitutifs de l’univers. L’homme peut se dire en bonne santé si ces quatre éléments s’accordent de manière harmonieuse dans son organisme : si l’un d’eux prévaut sur les autres, soit à cause d’un état maladif, soit à cause de l’âge (les jeunes étant plus " chauds " et " humides ", les vieux plus " froids " et " secs "), du climat, du milieu dans lequel on vit, de l’activité que l’on exerce ou pour quelque autre raison, il est indispensable de rétablir l’équilibre par les moyens appropriés, parmi lesquels le contrôle de l’alimentation. Par exemple, une personne atteinte d’une maladie qui la rend trop " humide " devra surtout consommer des aliments de nature " sèche " et vice versa. L’individu en bonne santé devra, en revanche consommer des aliments équilibrés ou, comme disent les médecins, " tempérés ". On a parfois appelé cette médecine la médecine " galénique " en hommage au médecin grec Galien qui vécut au IIe siècle et qui exerça une influence considérable jusqu’au 17e siècle. A la fin du 19e siècle, grâce à la physique, l’électricité, la chimie, la médecine porte son attention sur les tissus et les fibres conductrices. Les qualités motrices du corps humain se déplacent des liquides humoraux vers la force musculaire. La bonne santé réclame alors un régime carné et fortifiant. La médecine passe du côté des riches mangeurs de la noblesse, relayés au 19e siècle par la bourgeoisie, le régime des campagnes perd de sa valeur, les paysans sont vus comme des " mangeurs d’amidon ". C’est dans ce contexte de permissivité médicale que se développe le discours de la gastronomie qui encourage tous les excès. En même temps, le discours sur la nutrition se met toujours en place et ce, depuis les travaux de Lavoisier et Laplace qui, depuis 1780, ont établi la destruction des aliments dans l’organisme au cours de la digestion qui est assimilée à une combustion. C’est dans ce contexte encore qu’en 1840, la distinction en trois grands types de nutriments est mise au point : protides, lipides et glucides (que le Dr Mialhe distingue comme matières albumineuses, grasses et saccharaoïdes). Liebig sera en 1850 le premier industriel à regarder ces aliments " azotés " (appelés aujourd’hui protéines) comme " formeurs de chair ", devenant les " éléments plastiques de la nutrition ". La recherche est internationale avec une certaine primauté allemande. C’est là que se forme l’idéal diététique moderne qui ne connaît que des calories au nom de la combustion des " principes nutritifs du sang ". Les rations alimentaires " normales " deviennent alors : 1 000 g de pain, 360 g de viande, 2000 à 2 500 g d’eau ". Si on se tourne du côté de la Chine, on note que c’est la cuisine qui fait respecter les grandes règles de la diététique donnée comme un fondement de la médecine traditionnelle. Aussi loin qu’on remonte dans le temps, les sources témoignent de l’importance que les Chinois accordent à leur nourriture : rites de la table, découpe des aliments, modes de cuisson, etc. Ce qui distingue la Chine du reste du monde est la profusion d’ingrédients inégalée qu’elle utilise pour sa cuisine ordinaire (gingembre, sésame, poivre, anis étoilé, vinaigre de riz, produits dérivés de la fermentation du soja). Mais la Chine pense l’alimentation et la santé un peu comme en Occident, du temps de la médecine galénique. La médecine chinoise pense la maladie comme un déséquilibre, la guérison comme un processus de compensation des contraires, mais le déséquilibre n’est pas pensé entre chaud et froid mais entre yin et yang, le tao intervenant comme " régulateur " de leur alternance : attention, ce sont là non des principes théoriques mais des catégories concrètes de la vie dotées d’efficacité. Il y a d’autres conceptions philosophiques qui font place à des essences, des énergies qui animent l’être vivant, une sorte de fluide conceptuel qui doit être nourri, car les activités, les sensations et les passions diminuent sa force. La nourriture est ainsi vue comme une source de vie. D’où l’importance de la fraîcheur des aliments : les animaux vivants sont choisis par le client à l’entrée du restaurant ou tués devant l’acheteur sur le marché. On le voit, on pourra penser une géographie des
cuisines lorsqu’on les aura beaucoup mieux théorisé qu’aujourd’hui.
On peut imaginer les grands types de cuisine et les types d’aliments consommés,
les modes de cuisson, les goûts aussi.
3. Les cuisines et les goûts vus par les pratiques sociales Souvent, pour appréhender les cuisines, on part des constats des sociologues comme Bourdieu qui ont donné des clés de lectures des sociétés assez convaincantes, comme celles de la distinction. Car la distinction est à l’origine d’une des identités alimentaires. Elle est le produit de forces de brassage, des forces " verticales ", particulières et des forces " horizontales ", totalisantes. Ce qui est de l’ordre du particulier se rattache aux paysanneries longtemps pourvoyeuses de produits alimentaires, aux terroirs offrant des qualités et des labels fortement investis par les mangeurs et, enfin, aux pratiques de cuisine et de consommation qui s’établissent dans les groupes aux cultures homogènes. Les populations s’approprient des techniques locales ou d’origine extérieure en fonction de leur capital social. Ces produits et ces plats témoignent d’une fonction symbolique plus ou moins élaborée qui servent de marqueurs identitaires vis-à-vis de l’extérieur. Leur visibilité, leur repérage leur donne une position " verticale ", identitaire qui exalte fortement le " localisme " et le particularisme. Mais ce marquage culinaire et culturel ne s’atténue pas moins du fait des contacts liés à des forces de diffusion, de brassage, d’homogénéisation, de métissage. Certaines classes sociales dont la force tient à la mobilité, au pouvoir de l’argent, au statut exercent sur ce patrimoine alimentaire localisé une pression marquée par l’enrichissement, l’échange, voire la substitution. Les princes, les prêtres et les marchands véhiculent des modes et des produits qui les distinguent des paysanneries, consommant du proche et du local, des produits inaccessibles au commun des mortels, des produits du lointain dont la consommation s’imposera, finalement, par mimétisme. Selon les contextes historiques et économiques, ils jouent un rôle moteur dans l’évolution des modes culinaires et des saveurs nouvelles. Avec les princes Là où les aristocraties se sont déployées avec un peu de faste à partir de la Renaissance européenne, on a assisté à la codification d’un ordre symbolique des repas très puissant. Cet ordre s’est diffusé ensuite au 19e siècle dans les néo-bourgeoisies industrielles et dans le Nouveau monde américain, donnant une image de l’excellence devenue l’une des marques de fabrique de la vieille Europe, qui s’était inspirée de Rome, de la Perse et du monde ottoman. Comme le montrent les exemples français, espagnols, anglais et autrichiens. Le repas gastronomique comme le banquet est une flatterie des cinq sens : voir l’abondance, sentir les mets, les manier par les mains et les couverts, entendre le bruissement des liquides précieux, le craquement des feuilletés et, surtout, goûter et manger, chercher des arômes et des saveurs, des textures, ce qu’on appelle la " valeur hédonique " des aliments. Les Scandinaves ont repris ce patrimoine-là dans les smörgasbord et les Slaves dans le zakouska en Russie, plein d’épate et d’ostentation. Peut-on avoir une idée du talent et de la fortune déployée dans ces pirojki, petit pâtés à pâte levée pour les mariages, dans ces coulibiac remplis de farce de riz, de poisson et de champignons pouvant rassasier dix personnes et de ces pelmieni, sorte de raviolis à pâte très fine garnis de viande de cheval ou de poisson, d’origine sibérienne mais rendus célèbres au XIXe siècle grâce au restaurant Lopachov de Moscou ou travaillait le meilleur cuisinier de Russie ? La passion des rois a été satisfaite aussi
par les boissons, Charles Quint demandant du vin jaune d’Arbois, la cour
d’Angleterre réclamant du thé et du café au 18e
siècle, Pierre-le-Grand exigeant du tokay hongrois.
Avec les marchands Cet exemple montre combien les marchands vont mettre à profit l’expérience accumulée par les cuisiniers des aristocrates. Cette " revanche " est prise dans les restaurants dont la naissance précède de peu la Révolution mais dont le nombre va s’accroître rapidement. Pourtant, toutes les villes marchandes du Moyen Age toscan, hanséatique ou hispanique voire français, élaborent des mets et des plats dont l’excellence est liée au maniement des épices et de la canne à sucre. A Bâle, les läckerli ont voyagé avec les banquiers depuis le 13e siècle : l’usage d’un carbonate de potassium avec du kirsch, des oranges et du citron confit témoignent des besoins de tous les marchands (voyager avec des produits qui ne se dégradent pas) et des influences du commerce (agrumes de Valence, par exemple). En Angleterre, le plumpudding est tout de même un plat cosmopolite : car, outre la graisse de rognons de bœuf, de la chapelure et de la farine, des raisins de Corinthe et du sucre, des amandes amères et du citron, de la noix de muscade et de la cardamome, des clous de girofle, des œufs, du rhum, de la crème, le tout servi avec une sauce au punch après avoir été flambé. On peut étoffer la gamme des produits qu’on doit aux marchands avec la charcuterie méditerranéenne : chorizo, prosciutto di Parma, salumi, sont sans doute liés à des systèmes de conservation par assèchement, mais surtout à des besoins pour la navigation au long cours. Toutes les opérations de salage des jambons pour leur soutirer de l’humidité, de battage pour faire pénétrer le sel, le repos dans les cellules fraîches avant le lavage à l’eau, le colmatage des parties dépourvues de couenne avec une pâte à base de saindoux, de farine et de riz et de poivre protégeant le jambon de la sécheresse, enfin, le séchage pendant 7 à 12 mois dans des caves où n’entre que très peu d’air frais assurant les transformations biochimiques qui donnent un goût si délicat, toutes ces opérations nécessitent les contrôles d’un maître-charcutier dont le talent donnera aux jambons de Parme et de San Daniele (Frioul) des saveurs et des textures inégalées. Trancher très fin de si grosses pièces charcutières , les apprêter pour les services de table de grand prix, les offrir avec du melon et du porto dont les sucres souligneront la finesse et la délicatesse du salage, tout cela mobilise des capitaux et procède d’une distinction que les marchands aiment à cultiver. On peut dire la même chose du chocolat en Suisse,
des fromages dans les montagnes et le Nord de l’Europe, dans les pays neufs.
Le vieux fonds paysan Abandonné, le vieux fonds paysan réinspire aujourd’hui les cuisines en Europe, du moins. Comment caractériser ces mets et cette cuisine ? Les mets sont surtout prisonniers de conditionnements simples pour être accessibles facilement : fromages, charcuteries comme le fameux Saumagen du Palatinat, une panse de brebis farcie dont le chancelier Kohl voulait faire un emblème national. Les modes de cuisson créent des types de plat qui ne changent pas si le système de cuisson n’évolue pas : la soupe, élaborée au cœur de l’âtre, en est l’exemple le plus riche, d’autant que ce terme cache une gamme étendue de plats liquides de légumes ou de viande bouillie. Les Russes l’appellent chtchty, oucha, borchtch ou solianka, terme signifiant mélange rappelant l’époque où chacun apportait quelque chose pour ce plat unique. Des déclinaisons existent dans tous les pays, comme le waterzoi belge, mélange de poissons frais de la mer du Nord auquel on ajoute des poireaux, pommes de terre, céleri. On pourrait parler du rôle des légumes, du pain et tous les plats à base de céréales dont la palette est infinie, mais pourtant simplissime à décoder, à partir d’une distinction entre ce qui est levé et ce qui ne l’est pas, répétant cette opposition ancienne, jusque dans l’Egypte pharaonique, entre le pain et la galette. On associera pour mémoire toutes les nourritures
" nomades " que se sont réappropriées les classes urbaines
: les crêpes, les gaufres, le sandwich que les Français ont
consommé à raison de plus d’un milliard d’exemplaires (trois
milliards d’euros de CA en 2003).
4. L’industrie agroalimentaire et la mondialisation On voit bien avec le cas du sandwich qu’on est dans un autre système alimentaire que celui des trois classes décrites précédemment. Le capitalisme industriel s’est, en effet, saisi de la
chaîne alimentaire aux Etats-Unis au 19e siècle
avec le déracinement de millions d’Européens vers les villes,
l’usage de nouvelles technologies comme le froid artificiel mais aussi
le taylorisme. La première invention – car il y en a une deuxième
– du froid industriel avec la mise au point de machines frigorifiques en
1876 va changer la nature de la distance, obstacle infranchissable pour
de nombreux produits comme le lait frais ou les fruits et légumes.
Les ceintures laitières et maraîchères vont se diluer
dans des aires de chalandise plus vastes, pouvant aller jusqu’à
l’échelon du millier de kilomètres pour les produits acheminés
par le rail et la route, mais plus loin encore si l’avion ou le bateau
frigorifique font la liaison avec le monde tropical africain et latino-américain
en toute saison, voire davantage s’il y a des opportunités de contre-saison
à saisir, comme le montre le cas de kiwis néo-zélandais
ou des pommes importés pendant l’hiver européen. C’est ce
même froid qui, à l’échelon domestique, ralentit la
corruption des produits laitiers et maraîchers, invente un nouveau
garde-manger domestique qui rend disponible un nombre considérable
de produits qu’il fallait consommer en circuits courts : viandes et poissons,
fruits et légumes, crème fraîche, herbes aromatiques,
etc.
Le taylorisme américain va jouer aussi pour de nombreux produits qui sont transformés et conditionnés en série. Certes, Nicolas Appert sait déjà stériliser les produits par la chaleur dès 1790 et les conserver dans des milieux anaérobies mais c’est l’invention de la boîte en fer-blanc cinquante ans plus tard qui étend le bénéfice de cette technologie à une gamme très vaste de produits. De l’emballage au contenu, l’industrie bâtit une chaîne de fabrication dont les systèmes les plus efficaces vont toucher les poissons et crustacés, les légumes qui supportent une précuisson, les soupes qui sont pasteurisées. L’autre exemple fameux est celui de la charcuterie avec l’embossage standardisé des saucisses à l’origine de l’alimentation rapide comme le snack. A ce stade, l’industrie agroalimentaire récupère
les valeurs des pionniers, des marins, des travailleurs à la dure
qui cherchent ces produits nomades simples, s’accommodant d’une consommation
rustique (pain, boisson alcoolisée) sans assiette, ni couverts.
Sur le modèle du corned beef américain, les Néerlandais
et Danois conditionnent le hareng en boîte tout comme les Allemands
qui affectionnent les épices consomment la rote Wurst en
toute circonstance. D’un autre point de vue, les sardines, foies de morue,
calamars, moules, thons (en miette), mais aussi les tomates (en purée
ou en concentré), poivrons, aubergines, oignons crus ou cuits en
boîte accroissent le potentiel de travail du cuisinier de restaurant
ou de l’industrie.
La deuxième invention du froid qu’est le surgelé
offre un filon supplémentaire à l’industrie d’autant
que la diffusion du four à micro-ondes dans les dernières
décennies du 20e siècle en atténue les
contraintes de l’usage. Avec le surgelé qui se généralise
à l’échelle domestique – et collective, comme dans la restauration
hors domicile – en Europe dans les années soixante-dix, on passe
d’une prise en charge industrielle des produits à celle des plats.
Les plats " cuisinés " saisis à – 18°C vont ainsi garder
la plupart de leurs propriétés et de leurs qualités
à une échelle de temps qui recule encore. Tout comme la dessiccation
extrême de certains produits tel le café lyophilisé
ou les céréales avaient déjà offert, dans les
années 1950, des opportunités de consommation déconnectées
de la cuisine. Ainsi, l’industrie du froid extrême, s’approchant
au plus près des consommateurs, fabrique-t-elle le " prêt-à-consommer
" dont les restaurateurs et les cuisiniers ont compris tout le parti qu’ils
pouvaient tirer pour enrichir leur carte.
Le prix de cette révolution technologique va être
lourd : il assujettit progressivement l’acte culinaire à l’industrie.
Non seulement, les " arts ménagers " miniaturisent pour l’espace
domestique les " robots " qui font du cuisinier un nouveau démiurge,
mais ils le rendent dépendant d’une palette de condiments et d’apprêts
(gélatines, mélasses) et de techniques de cuisson au four
domestique. Au Danemark déjà, l’installation du fourneau
dans les cuisines au 19e siècle avait fait évoluer
la consommation du porc du bouilli vers le rôti tout comme en Allemagne,
l’électrification des kiosques avait multiplié les prises
alimentaires hors domicile. On prend ainsi toute la mesure du mouvement
de désacralisation du repas comme moment social fort auquel les
populations européennes souscrivent d’autant mieux qu’il porte des
valeurs individualistes, qu’il satisfait l’autonomie face aux lois de la
vie communautaire.
Mais il y a plus encore, avec la diffusion du prêt-à-consommer
des grands cuisiniers qui cèdent des droits de propriété
intellectuelle culinaire à des groupes agroalimentaires : les plats
de haute couture gastronomique, passés au 19e siècle,
des hôtels particuliers de l’aristocratie aux restaurants étoilés
de la bourgeoisie sont en passe de gagner la plus modeste des tables grâce
à la surgélation. L’industrie se réapproprie les valeurs
élitistes de la gastronomie du Grand Siècle par un marketing
astucieux mêlant les valeurs de la distinction (logos et photos appropriés
sur les emballages) et celles de la diététique.
Car aucune innovation culinaire en Europe ne passe sans l’aval du corps médical. Constamment sollicités par des publications grand public sur les bienfaits et méfaits de tel produit, les médecins offrent une caution indispensable à la consommation de masse de ces produits neufs. Si l’on veut pister les valeurs des modes alimentaires européennes, il faut exploiter deux registres qui se rejoignent dans l’idéal d’un plaisir gratuit et absolu :
Ainsi, la révolution de palais européenne
est-elle moins profonde qu’on ne l’imagine, l’industrie capitalisant
les saveurs et les plats, les noms de la gastronomie et les qualités
des terroirs par les labels, appellations d’origine et garanties de qualité.
Mais avec l’industrie agroalimentaire, les Européens deviennent
ethnivores et cherchent l’exotisme autant dans l’origine régionale
des plats, estampillés " anglais ", " suédois " ou " grec
" que dans des goûts plus complexes qui mêlent plus de saveurs.
Les forces de brassage ont accru leur rayon d’action à l’échelle
mondiale et offrent, pour le quotidien des villes, aussi bien des sushis
japonais
que des tortillas mexicaines.
Conclusion Le système alimentaire mondial est une construction sociogéographique qui brasse une quantité considérable de produits et de cuisines, de manières de tables fixées par des cultures largement ouvertes. Sa géographie montre le rôle déterminant joué par des acteurs aux ressources culturelles hétérogènes qui se transmettent de manière continue des façons de boire et de manger, des produits et des plats, des goûts et des saveurs, le capital de saveurs étant réinvesti par une industrie agroalimentaire en quête de nouveaux marchés. Le succès de l’acteur industriel tient sans doute au fait qu’il pratique des formes d’homogénéisation qui sont dans sa nature mais en consentant à exploiter aussi des symboles identitaires puisés dans les saveurs et les terroirs. Une forme d’alliance subtile entre forces de brassage verticales et horizontales. Aujourd’hui, on peut dire que l’expansion des cultures culinaires est dans une phase active :
|