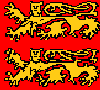 |
H&G - Chronique Internet Enseigner l'Histoire, la Géographie, l'ECJS |
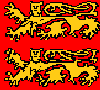 |
H&G - Chronique Internet Enseigner l'Histoire, la Géographie, l'ECJS |
La Grande Guerre : Armées,
Combats, Sociétés
Conférence d'Antoine
Prost,
Dans Les sociétés en guerre (1911-1946),
l’ouvrage coordonné par Bruno Cabanes et Edouard Husson,
La première guerre mondiale a suscité une
importante littérature :
Dans l’Entre deux guerres, la problématique principale prolonge l’art 231 du traité de Versailles : qui est responsable du déclenchement du conflit ? Cela favorise une histoire diplomatique et militaire dans laquelle les historiens sont minoritaires. Dans un premier temps, les ouvrages les plus nombreux sont publiés par les témoins, surtout les généraux et les hommes politiques : Joffre, Pétain, Mangin, Poincaré, Clemenceau, Tardieu… Une exception à noter, celle de Pierre Renouvin qui a posé, dès 1925, dans son étude sur Les Origines immédiates de la Guerre (28 Juin - 4 Août 1914) – Paris 1925, l’essentiel des enjeux du conflit. En 1961 , l’Allemand F Fischer a plus confirmé que contredit cette analyse pionnière. Après 1940, la perspective a changé. De Gaulle parle en 1941 de la " nouvelle Guerre de Trente Ans ". L’écho de Stalingrad, le triomphe de Staline et du communisme incitent à réévaluer la place de la Révolution russe. La question du rapport de la guerre et de la révolution, négligée entre les deux conflits – sauf lors d’une conférence de Daniel Halévy à Oxford en 1929 - devient la question centrale. Depuis une vingtaine d’années, c’est Auschwitz qui occupe le centre de l’imaginaire collectif. C’est à partir d’Auschwitz que l’on recompose l’histoire du XXeme siècle. Les historiens recherchent des précédents, comme le génocide des Arméniens en 1915 ; ils mettent l’accent sur " l’ensauvagement ". Le XXème, c’est alors le siècle de la barbarie, la première guerre mondiale devient la matrice de cette barbarie. En 1990, dans son ouvrage " Fallen soldiers ", G. Mosse parle de " brutalisation " ; le concept est repris et développé par Stéphane Audoin-Rouzeau dans la préface qu'il donne à la traduction française de ce livre. En fait, pour Antoine Prost , la première guerre mondiale est plutôt la dernière guerre du XIXème, elle marque la fin du cycle des nationalismes. C’est ce que souligne Raymond Aron dans " Paix et guerre entre les nations ". La nation se définit par le droit de faire la guerre sans demander l’autorisation à personne. Une vision reprise récemment par GW Bush. Le lien entre nation et guerre est essentiel. Le concept de " guerre civile européenne " qui évacue la dimension nationale interdit absolument de comprendre pourquoi la guerre a eu lieu. Pour sa thèse sur les Anciens combattants de
1919 à 1939, Antoine Prost a été amené
à recueillir de très nombreux témoignages d’hommes
qui ont combattu entre 1914 et 1918. Pour lui, il n’y a pas de " combattant
européen " (Frédéric Rousseau), mais des expériences
différentes d’un pays à l’autre, en fonction des réalités
vécues dans chacune de ces sociétés.
- Quelles sont les différences entre les trois grandes armées de l’Europe occidentale ? - Quelles conséquences sur la façon dont la guerre s’est faite ? - Quels ont été les effets de la guerre
sur les sociétés ?
Les armées 2 armées de conscription (F, All), une armée de métier. La France de 40 millions a une armée active
de 870 000 hommes en 1913. Deux réserves la complètent.
L’Allemagne a 910 000 soldats dans son armée
active, pour une population de 60 millions d’habitants.
En Allemagne, la noblesse a gardé le monopole des
épaulettes. La moitié des officiers prussiens est noble :
les jeunes gens doués choisissent la carrière militaire,
là où les Anglais vont à Oxbridge, puis à la
Cité ou dans l’armée des Indes. Les élites françaises
choisissent plutôt Sciences Po et le Conseil d’Etat, ou Polytechnique
; une minorité choisit l’armée. Joffre en est un parfait
exemple, polytechnicien, officier du Génie, très doué
pour la logistique, pour organiser le repli de son armée durant
l’été 14, mais sans véritable pensée stratégique
: passer à l'offensive sur tout le front avec toutes ses forces
n'est pas un "plan" au sens de l'Etat-major allemand.
La France républicaine a mis en place une armée
plus proche du peuple. Il n’y a que 20% de généraux nobles
(l’affaire Dreyfus, le général André avec ses fiches
sont passés par là). André Maginot, député
de la Meuse, mobilisé à Verdun surprend un de ses électeurs
qui pensait que les hommes politiques s’étaient réservés
les grades les plus élevés. Il rapporte : " cela plaît
à son goût pour l’égalité et lui fait dire :
" c’est beau la république " ".Maginot sera blessé en 1915
et finira la guerre avec le grade de sergent.
La Grande Bretagne compte essentiellement sur la
flotte, qui lui a permis de dominer le monde, et dont on espère
qu’elle protégera l’île de l’invasion.
C’est une armée " ascriptive ", fortement marquée par le sens de la hiérarchie sociale, le respect des convenances et la parfaite maîtrise des codes aristocratiques. De 1914 à avril 1916, la Grande Bretagne parvient à recruter une armée de 2,6 millions d’hommes, en faisant seulement appel au volontariat : that ‘s incredible ! Des pères de familles s’engagent pour aller se faire tuer dans la boue des Flandres ou de l’Artois. La vraie question, ce n’est pas " comment ont-ils tenu ? " mais bien " pourquoi sont-ils partis ? " Il s’agit d’une armée de copains, qui fonctionne
sur la solidarité locale, sur la sociabilité de classe. L’engagement
se fait souvent en groupe, entre copains (Pal’s battalions) : anciens élèves
d’un même collège, membres d’une équipe sportive, ouvriers
d’une même usine, habitants d’une même communauté.
Des sociétés très différentes dans leur rapport à la chose militaire En Allemagne, l’Etat-major est un pouvoir à lui seul, il est seulement responsable devant l’empereur (tout comme le chancelier). Durant la guerre, l’EM conteste le pouvoir du ministre de la Guerre, et constitue sa propre bureaucratie, ce qui est un facteur de désorganisation. Ni l’empereur, ni le chancelier n’ont le dernier mot en matière de stratégie. A Guillaume II qui voudrait envoyer davantage d’hommes sur le front russe, Moltke le jeune rétorque qu’il n’en est pas question, qu’il faut suivre le plan Schlieffen et vaincre d’abord la France. En 1917, l’Etat-major obtient la démission du chancelier Bethmann-Hollweg. Ce pouvoir militaire est à mettre en relation avec le pouvoir social des Junkers et des académies militaires. En Grande Bretagne, l’armée est intouchable (comme la Chambre des Lords ou comme la perruque du Lord Justice). Elle fait partie de la tradition et mérite pour cela le respect. Haig, un général en chef aussi contesté que Nivelle en France, est impossible à limoger. Pourtant, en juillet 1916, lors de l’offensive de la Somme, il a montré son manque total d’imagination : il a fait donner l’artillerie pendant huit jours ; quand il arrête pour lancer l’offensive, les Allemands sont prévenus. L’attaque anglaise débouche sur un massacre horrible. Lloyd George est conscient de ces erreurs et de ces limites ; mais Haig est trop bien en cour et il bénéficie du soutien de la presse…Il reste donc à son poste jusqu’en 1918. Au R-U, les deux pouvoirs font jeu égal. Néanmoins,
le pouvoir civil a l’initiative de la stratégie. Parfois ce n’est
pas très heureux : Churchill, secrétaire de l’Amirauté,
est à l’origine de l’expédition des Dardanelles (1915), un
échec…
En France, on commence comme en Allemagne. Joffre est tout puissant, l’EM dispose de tous les pouvoirs. Le pouvoir politique accepte sans difficulté de se replier sur Bordeaux quand Joffre le lui demande. Le gouvernement donne très tôt à l'armée, dès la première quinzaine d'août 14, un pouvoir judiciaire d’exception, avec des conseils de guerre spéciaux qui statuent sans instruction préalable, et qui exécutent les sentences dans les 24 heures. Mais en France, des députés sont mobilisés (A. Maginot, Abel Ferry…). Leur vue d’en bas ne cadre pas avec les analyses et les discours de l’Etat-major. Ces hommes politiques s’aperçoivent que notre artillerie lourde est insuffisante. La France a tout misé sur le canon de 75, relativement léger et facile à déplacer. Logique puisque le seul plan de guerre de nos généraux (le fameux Plan XVII) peut se résumer par : l’offensive à tout prix. Si l’offensive rate, c’est que les exécutants n’ont pas été à la hauteur, qu’ils ont manqué de cran ; alors on limoge, on fusille ! C’est la commission sénatoriale de l’armée qui va imposer à l’Etat-major le renforcement du programme d’artillerie lourde. L’intervention du pouvoir civil dans la guerre met fin à une éclipse de courte durée (août – décembre 1914) où Millerand couvrait les décisions de l’Etat-major . Joffre est écarté à la fin de 1916, puis Nivelle après l’échec de son offensive en 1917. Le Parlement se donne un moyen de contrôle : les
crédits ne sont votés que pour 6 mois ; les commissions parlementaires
peuvent faire leur travail.
La guerre et l’économie En France et au Royaume Uni, c’est le pouvoir civil
qui organise la main-d’œuvre et supervise la mobilisation de l’économie.
En France, un socialiste, Albert Thomas, est ministre de l’Armement , en
GB, c’est Llyod George. La gestion des ressources se fait par un consortium
dans lequel on trouve déjà Jean Monnet.
En Allemagne, c’est le pouvoir militaire qui prend
en charge la mobilisation économique. Le général Groener
met en place une bureaucratie tentaculaire.
Un constat s’impose donc : des sociétés
très différentes où le poids de l’armée n’est
pas du tout le même.
Quel est le poids de la société dans les armées allemande, anglaise et française ? ·La société allemande ne pèse pas beaucoup sur l’armée allemande. La force de l’armée allemande repose sur le groupe primaire et son encadrement. Le noyau fondamental est constitué de 110 000 sous-officiers (seulement 50 000 en France pour une armée de taille équivalente). Une armée commandée de très près, c’est important pour les travaux de terrassement. Les soldats allemands qui creusent leurs tranchées sont surveillés par des sous-officiers qui sont autant de contremaîtres pointilleux et très présents. (cf. la qualité des tranchées allemandes du Chemin des Dames). En contrepartie, cette armée a deux grandes
faiblesses :
2) L’écart entre les officiers et la troupe. Les officiers constituent une caste à part. Leur pouvoir ne repose pas sur le contact direct avec les soldats. Il donnent les ordres aux sous-officiers qui commandent les hommes. Les volontaires bourgeois, des étudiants engagés (du fait d’un nationalisme particulièrement vif en All) posent aussi des problèmes. Pour les soldats allemands, ce sont des êtres bizarres qui choisissent d’aller à la guerre. Quand ils reçoivent des colis, leur comportement est toujours critiqué : soit ils les partagent, au risque d’apparaître paternalistes, soit ils se les gardent, et alors ils font figure d’égoïstes (à comparer avec l’image du patron pour un socialiste : il n’y a pas de bons patrons, seulement des patrons paternalistes et des négriers). Cette armée allemande a connu peu de cas de mutineries (30 à 40 dans toute la guerre), mais elle est capable de se décomposer, ce qui arrive en août 1918 : elle perd 100 000 prisonniers en un mois. De plus, le commandement est incapable de faire remonter
au front les permissionnaires. Ernst Junger, officier des troupes d’assaut,
dans une lettre de 1918, félicite un ami lieutenant : " j’imagine
ta satisfaction d’avoir rendu tous tes hommes à ta division avec
seulement 25 % de manquants ".
·Le Royaume-Uni est un pays de citadins, mais un pays profondément aristocratique. Les officiers sortent des public schools (Eton, Rugby,
Arrow…) : ce sont des "educated soldiers", "born to rule" (nés pour
commander). John Keegan, dans The face of the battle, explique le cas d’un
junior officer, un officier de réserve de 42 ans, sollicitor dans
le civil, à qui le serveur du mess refuse du whisky : celui-ci est
réservé aux officiers de rang supérieur. Dans cette
logique, la formation militaire est très réduite.
L’armée combat sur un sol étranger, les permissions ne sont très rares (la Manche à traverser). Les temps libres sont organisés à l'imitation des Publics schools, mais en s'adaptant à la culture populaire britannique : football (et non rugby), compétition de cross-country, music hall, concours de creusement de tranchées… Le style de commandement mis en place s’adapte à la société anglaise, une société précocement urbaine (75 % en 1914) : on combat juste ce qu’il faut, tout comme les ouvriers à l’usine travaillent juste ce qu’il faut ("work to rule") ; on transfère au front le sens de l’humour. Les soldats disent " Yes, sir " à leurs officiers. Par contraste, le tutoiement est habituel dans les régiments australiens ou néo-zélandais qui mènent une guerre de pionniers, de cow-boys ; dans ce cas, les officiers demandent à leurs soldats d’arrêter de les appeler par leur prénom quand ils sont passés en revue par un officier britannique ! Le combattant britannique a une très forte confiance en lui : l’Angleterre est le pays le plus puissant, elle ne peut être vaincue à la guerre. Cela lui permet de jouer le jeu (" play the game "), de vivre et laisser vivre (" live and let live ") : on ne s’acharne pas sur la tranchée adverse si elle ne vous attaque pas : "ne pas réveiller un chien qui dort" (vrai aussi pour les Français). Cela garantit des moments tranquilles dans des secteurs calmes du front. La France : l’armée est plus démocratique. Après six mois de guerre, une part importante de l’encadrement a dû être renouvelé. Les officiers des tranchées viennent donc du rang, ce sont des civils qui gardent leur manière d’être. Dans ce cadre, le commandement est une négociation permanente. Dans son étude sur la 5ème division, celle de Mangin ("Between Mutiny and Obedience", Princeton University Press, 1994), Leonard Smith montre que la discipline résulte d’un calcul implicite, d'un principe de proportionnalité : celui du rapport acceptable entre l’effort demandé et le résultat qu’on peut en retirer. Il interprète ainsi une panique du début septembre 1914 : c’est une manière pour les soldats de dire au commandement " trop, c’est trop ". Le message est reçu, car il a été relayé par les officiers de réserve. Len Smith distingue, dans les récits, le registre officiel (official transcript) et le registre souterrain (hidden transcript). Dans le premier, les rapports d’opérations montrent une armée en ordre de bataille ; en fait, les patrouilles n’ont pas toujours eu lieu… Il y a tout un jeu entre ce qu’on fait réellement et ce qu’on dit qu’on fait. Les soldats français sont des soldats-citoyens et ils le savent. Entre juillet 1916 et avril 1917, il y a dans la division Mangin, 50 condamnations à mort pour désertion ; aucune n’a été suivie d’exécution. Les soldats ont seulement été renvoyés au front. Pourquoi, si le risque était aussi mesuré, n’y a-t-il pas eu plus de désertions ? Len Smith pense que les mutineries de 1917 ont été gérées comme une grève : l’Etat-major a voulu éviter l’irréparable : surtout ne pas faire tirer des soldats français sur d’autres soldats français. Les mutins, de leur côté, ne se trompent pas : ils demandent que leurs revendications soient transmises au ministre. Ils demandent un changement de stratégie. Il s’agit bien d’un geste politique, au plein sens de ce terme : pas au sens imaginé par quelques généraux, pour qui le mouvement serait le fait de quelques meneurs ; mais au sens de soldats qui sont en même temps des citoyens, des électeurs qui savent mesurer l’écart entre l’effort demandé et le résultat. Pétain, dont la nomination n’arrête pas immédiatement
l’apparition des mutineries, a cependant compris le message : il rétablit
et réorganise les permissions. La permission n’est pas un divertissement,
mais un droit, comme la chasse. En France, les soldats-citoyens consentent
à la guerre. Le consentement existe bien, mais il est conditionnel.
Culture(s) de guerre et brutalisation Depuis G. Mosse, la guerre serait un processus de totalisation, de modification en profondeur des sociétés européennes. Cette thèse, reprise et développée par Stéphane Audoin-Rouzeau, qui est passé du pluriel (les cultures) au singulier (la culture de guerre), doit être nuancée fortement. Elle n’est pas totale. La rupture entre l’avant, le front, et l’arrière, occupe deux chapitres dans la thèse de Stéphane Audoin-Rouzeau (14-18, les combattants des tranchées, 1986). Elle est signalée par tous les témoignages. L’arrière est souvent détesté. Pour les soldats, c’est domaine de la vie facile, de l’absence de risque, des questions stupides. C’est aussi le lieu des amours, des projets. Les soldats attendent surtout une reconnaissance en échange de ce qu’ils font, une reconnaissance qui ne peut pas être au rendez-vous. Comment dire un merci à la hauteur des sacrifices consentis ? Il en résulte une incompréhension durable. En général, dans les correspondances, la réalité des combats ne transparaît guère. Sauf en 1917, quand la coupe déborde, et encore avec prudence et modération ; mais les soldats pensent alors qu'il faut " qu’à l’arrière, ils apprennent ce qui se passe sur le front ". Pour Stéphane Audoin-Rouzeau, le fossé serait surmonté par la vigueur du sentiment national : soit, mais sous quelle forme ? Lors du colloque de Montpellier (1998, publié en 2002), Stéphane Audoin-Rouzeau fait de la culture de guerre un agent de totalisation progressive du conflit. Ce ne serait pas la guerre qui nourrit la culture de guerre, mais la culture de guerre qui déterminerait le déroulement de la guerre. 4 éléments structureraient cette culture de guerre : la violence, la haine, le consentement, l’eschatologie. Pour Stéphane Audoin-Rouzeau, les anciens combattants auraient aseptisé leur guerre : ils tuent rarement dans leurs témoignages. Pour lui, la pointe extrême de cette violence est ainsi passée sous silence. Cette violence extrême aurait été masquée par la culture pacifiste de l'entre-deux-guerres, et la volonté des témoins de donner une bonne image d'eux-mêmes. Mais c'est elle qui donne son sens à la guerre. Inversement, Stéphane Audoin-Rouzeau conteste l'importance donnée aux témoignages de fraternisation, qu’il met au compte d’une historiographie complaisante. Il renverse le rôle attribué à la propagande. La violence ne résulte pas d’un conditionnement, mais bien d’un vaste mouvement de haine de l’Allemand, venu d’en bas. Mouvement qui rend inutile l’usage de la censure, et qui permet un consentement pouvant aller jusqu’à la ferveur. Dans la revue Genèses, n° 53, décembre
2003, Nicolas Mariot (Faut-il être motivé pour tuer
? Sur quelques explications aux violences de guerre) analyse de façon
approfondie cette présentation.
Antoine Prost reprend son étude dans l'article
de Vingtième siècle ;
Tuer à la guerre, c’est rare. Et plutôt difficile.
Antoine Prost rapporte ainsi le témoignage de Braunstein, un des
combattants de la MOI (Main d’œuvre ouvrière immigrée), qui
a tué en 1941 à Nantes un officier et un soldat allemands.
Il avait la veille croisé un officier allemand dans la rue, mais
n'avait pu se résoudre à le tuer de face. Le lendemain, il
a tué ses deux allemands, mais en leur tirant dans le dos.
Dans " An Intimate History Of Killing: Face-To-Face Killing In 20th Century Warfare", Joanna Burke confirme qu’à la guerre on ne tue pas tout le temps. Le témoignage de Blaise Cendrars est parfois utilisé. Son " J’ai tué " est un travail d'écriture qui traduit la précipitation et le halètement de la bataille. Mais Cendrars appartenait à la Légion étrangère, il n’était donc pas un soldat ordinaire. Ernst Jünger est un tueur et fier de l’être.
Mais même lui est accessible à la pitié.
Antoine Prost a aussi interrogé, en 1978, Maurice
Genevoix.
Devant la culture de guerre reprise de l’œuvre de G. Mosse, Antoine Prost semble très dubitatif. Il y a pour lui plusieurs cultures de guerre : celle de l'arrière et celle du front sont différentes, et celle de 1914 de celle de 1917). Le passage du pluriel au singulier lui semble très simplificateur. De même, il faut tenir compte des cultures nationales, ce qui le rend prudent sur la brutalisation. Pour lui, la guerre n’a pas transformé les hommes en brutes. Bien sûr, l’Allemagne de Weimar a connu, après la défaite et le renversement du Kaiser, le passage de la violence militaire à la violence politique. Les troupes d’assaut ont été transformées en corps francs. Plus de 500 meurtres ont eu lieu, tous amnistiés avant l’arrivée au pouvoir d’Hitler. Mais cette brutalisation est sans doute à mettre en relation avec la culture politique allemande : l’expérience de la mort de masse a été ici intégrée dans une culture bien antérieure à la guerre. De fait, en Allemagne, pour beaucoup de théoriciens,
la force prime le droit. Le darwinisme social est très répandu
: le monde appartient au plus fort, la guerre est un examen de passage
auquel les nations ne peuvent se soustraire : seules les nations guerrières
ont le droit de vivre. Voir par exemple le succès de Von Bernhardi
en 1912
Ajoutons que cette culture politique s’applique après
1918 à un pays vaincu, à un peuple assoiffé de
revanche.
Pour Antoine Prost, cette thèse ne fonctionne pas en Grande Bretagne (patrie de l’Habeas Corpus), ni en France, le pays où en 1791, la nation, c’est la base du régime (La Nation, la Loi, le Roi). Après 1871, la France a bien connu une volonté de revanche. Mais, au temps de la Belle époque, c’est plutôt un patriotisme défensif qui se développe. Voir l'article de J. et M. Ozouf repris dans le volume édité par Antoine Prost récemment (Guerres, paix et sociétés, Les éditions de l'atelier). Il n’est plus question de revanche, on espère obtenir réparation par la voie de la négociation. Après 1918, chez les anciens combattants étudiés
par Antoine Prost, c’est plutôt une culture pacifiste qui s’est
développée, et Norman Ingram a bien montré le
développement, à partir de 1929, d'un pacifisme radical.
Le pacifisme des Britanniques a été étudié, de son côté, par Martin Ceadel : Sans oublier que France et Grande Bretagne sont deux pays qui sortent vainqueurs de la guerre. Au total, la thèse de la brutalisation nous dit plus de choses sur la société d’aujourd’hui que sur celle de 1914-1918. Elle témoigne des interrogations sur notre société, celle qui a permis Auschwitz, Pol Pot, l’ex-Yougoslavie, le goulag. En fait, la question à poser, ce serait : s’il y a eu cultures de guerre entre 1911 et 1946, comment en sommes-nous sortis ? (c’est une approche beaucoup plus optimiste : quelles seraient les raisons d’espérer pour aujourd’hui ?). Cela permettrait d’étudier les limites de la brutalisation, de repérer quels antidotes ont été efficaces. Pour Antoine Prost, l’histoire n’est pas un exercice de compassion,
Questions : 1 Quelles ont été les relations entre soldats et officiers dans les troupes coloniales ? Du côté anglais, les bataillons venant des
dominions sont encadrés par leurs propres officiers.
2 – Les instituteurs à l’armée Beaucoup ont fini comme chef de section, mais ils n’ont
pas toujours laissé un bon souvenir : ils ont pu être assez
autoritaires.
Après 1918, ils s'interrogent sur leur patriotisme défensiste et se convertissent au pacifisme. Mais Antoine Prost souligne l’application de la laïcité et de la neutralité à cette option politique : les instituteurs savent faire la distinction entre ce qu’ils croient et ce qu’ils enseignent aux élèves, entre un choix personnel et une pratique de la classe. Le rôle de l’histoire dans la formation du patriotisme est débattu, par exemple en 1927. Mais les programmes n’ont pas bougé, même avec Jean Zay en 1937. 3 – Le front germano-russe et la brutalisation Chez les Allemands, avant 1914, l’idée se développe que la guerre est inévitable entre Germains et Slaves. Le darwinisme social et une vision ethniquement déterminée de la politique internationale le conduit à penser cet affrontement comme une logique inéluctable de l’histoire. Ce qui les conduit à amplifier la menace, et à surévaluer par exemple la solidarité entre "Slaves du sud" et Russes. La déshumanisation de l’adversaire est un élément
de cette brutalisation, surtout quand les différences culturelles
sont importantes ou exagérées.
4 – L’antisémitisme dans l’armée allemande ? Il existe un antisémitisme diffus. L’Etat-Major donne l’ordre de recenser tous les Juifs dans l’armée allemande. Les résultats de l’enquête infirment les soupçons selon lesquels ils auraient été planqués. Ils ont été diffusés aux commandants de corps. Mais le fait même d'avoir lancé cette enquête atteste un antisémitisme latent. L'affaire Dreyfus aurait été impossible en Allemagne, car un officier juif ne serait jamais arrivé à une position de responsabilité dans l'Etat-major. Eléments de bibliographie et de webographie Douglas
Haig, Héros ou boucher ?
1914-1945, Cartes en ligne : http://www.atlas-historique.net/1914-1945/index.html DL avec l’aide de Denis Madelain, de Marion Onraed, de Jacques Soria – 01/2004
|